JEAN-LOUIS AUBERT : LES PARAGES DU VIDE (2)
7 mai 2014. 13h50. Paris 6e. Bistrot des Amis. « On va peut-être rentrer avant que ton truc prenne l’eau ? » Une demie heure qu’on parle avec Jean-Louis en terrasse, de Aubert chante Houellebecq – Les parages du vide, son dernier album sorti ce 14 avril, que j’aime beaucoup. Une demie heure qu’on parle d’Houellebecq, de médias, de chansons, de poèmes, de Philippe Garrel, de Philippe Manœuvre, de Téléphone et de philosophie parce qu’initialement je suis là pour Philosophie Magazine. Une demie heure et voilà, c’est pas fini ! mais il s’est mis à flotter alors on file à l’intérieur, lui, moi et mon « truc » : le petit Zoom H1 par le biais duquel je l’enregistre.
Aubert quoi ! Le mec de Téléphone (1976 – 1986), un des premiers vrais groupes de rock français à succès et à s’exporter. Cinq albums studios, 14 tubes, 470 concerts, des ouvertures pour Télévision, Iggy Pop, les Stones, et plus de 6 millions d’albums vendus, « compilations » comprises j’imagine. Et pas moins de 10 ont paru depuis le dernier album du groupe. Aubert, le mec d’« Hygiaphone », « Métro (c’est trop) », « Flipper », « Crache ton venin », « Fait divers », « La Bombe humaine », « Au cœur de la nuit », « Argent trop cher », « Fleur de ma ville », « Ça c’est vraiment toi », « Cendrillon », « New-York avec toi », « Un autre monde » et de « Le jour s’est levé ».
Aubert, le type de la radio, que j’ai écouté ado. Je n’ai jamais volontairement écouté Téléphone mais je me rappelle que vers 16-17 ans, aux soirées dansantes du village vacances où je passais mes étés on dansait comme des dératés sur ça, « Hygiaphone », « Ça (c’est vraiment toi) », « New York avec toi », comme on dansait sur les Rita, « Marcia baïla », « C’est comme ça », « Les Histoires d’A. », comme on dansait sur Louise Attaque, REM ou Nirvana. C’était la nouba. Mais je n’ai jamais eu aucun album de Téléphone et d’Aubert. Tout ça émanait de quelques Greatest Hits, comme le « Bohemian Rhapsody » de Queen (les fameux I et II). Souvenirs déformés. Best ofisés.
Aujourd’hui, à tout réécouter en faisant fi de toute mythologie, je m’aperçois que la discographie de Téléphone n’est pas si super que l’idée que je m’en faisais. Il n’y a pas plus de trois tubes par disque et le reste est dispensable. Alors que certains albums « solo » d’Aubert tiennent sacrément la route. Plâtre et Ciment (87) et Bleu Blanc Vert (89) c’est encore un peu faible malgré quelques pépites. « Juste une illusion », « Les plages » et « Quand Paris s’éteint » pour l’un. « Voilà, c’est fini » et « Univers » pour l’autre. Accuse-t-il sa trentaine ? Le fait de ne plus avoir Richard, Louis et Corine ? On sent que les années 80 sont dures pour l’Enfant du rock. Mais pas les 90’s.
Ponctué par les tubes « Entends-moi », « Toi que l’on n’homme pas », « Temps à nouveau – à l’eau » et « Moments », H (93) est presque top de A à Z et avec Stockholm (97) ça y est, on frôle le « grand œuvre ». C’est plus sombre, tortueux, épais. Il y a déjà là certains mariages orientaux rock trip hop pro-toolisés que Bashung proposera avec Fantaisie militaire, et même certains textes jeu de mots qu’il aurait pu faire sien. Après Aubert donnera l’impression de dérouler avec Comme un accord, Idéal standard et Roc éclair, sommet de rengaines entêtantes. Trois autres disques bien bâtis, solides, où isoler les tubes radiophoniques serait stupide. « Comme un mur dans un pré ».
Du coup c’est bizarre et cool d’avoir ce type devant moi. Aubert, passivement, il fait tellement partie de ma vie, de mon décor, qu’une nuit j’ai rêvé qu’on discutait et qu’on fumait un joint ensemble. Là, on était en train de parler de ce point de bascule souvent galvaudé où l’intime confine à l’universel, et je parle de galvaudage car je trouve toujours assez gonflé que l’homme puisse se prévaloir d’une quelconque universalité. Y’aurait pas un problème d’échelle ? L’homme c’est l’homme et l’univers c’est l’univers. Ne mélangeons pas l’infini et les caniches. On est lancé, dans le « truc ». Il a déjà fumé quatre clopes. Et si on se rentrait pour attaquer le vif du sujet ? Oui, inside Jean-Louis.
« Lou Reed me disait toujours : Téléphone ? That’s hippy stuff ! »
Jean-Louis, parlons plus précisément de philosophie. Tu disais que les êtres passionnés, qu’ils soient écrivain, peintre, chanteur, menuisier ou je ne sais quoi d’autre, sont souvent dans des « stratégies enfantines » ou « régressives ». Penses-tu que ça s’applique aussi aux philosophes ?
Oui, parce que quand tu regardes Nietzsche, qui est le philosophe que je connais le plus, tu vois que tout ce qu’il a fait ressemble aussi à un phénomène régressif, assez personnel, c’est l’envie de refaire le monde depuis sa chambre d’étudiant quoi. On a aussi dit ça de Che Guevara aussi, qui a été élevé en université avant de voyager et d’arriver dans un pays où il a pu appliquer ses rêves d’utopies. Il a pu le faire en vrai parce que le pays était sens dessus dessous. Et il l’a fait avec des rêves qu’il avait forgé dans sa piaule d’étudiant, voilà. On peut donc voir ces deux-là comme de grands tyrans hein, parce que Hitler a aussi eu une période Beaux-Arts, où il était rejeté, solitaire, pas très tourné vers les autres. Tout ça c’est beaucoup le fruit d’une construction personnelle.
Du coup ça peut être violent quand les rêves de chambres d’ado débarquent dans la réalité…
Ah oui, oui, oui. Et pour moi quelque fois ces gens c’est juste des catalyseurs en fait. Parce que pour devenir ce qu’ils sont il faut encore qu’ils soient reçu par les autres. Des Hitler y’en a régulièrement qui montent sur les tables des cafés mais ils ont moins de succès que celui-là à cette période-là.
Oui, c’est ça : qu’est-ce qui fait qu’à un moment donné un type donné trouve un tel écho…
C’est l’adhésion des autres. En fait, des Hitler y’en a tout le temps. Bah c’est comme une maladie (petits rires) qui est toujours là, tout le temps, et puis quelque fois elle se développe parce que psychologiquement…
Y’a un terrain propice…
Oui, voilà, t’es dans une impasse et finalement t’es un peu prêt à accueillir le truc. Parce que regarde, les mères qui ont 8-10 enfants, elles ont pas souvent la grippe, curieusement (rires) ! Leur terrain est pas propice (le serveur arrive, on passe commande, « petit cheeseburger à point avec frites salade » pour lui, confit de canard pour moi, et eau du robinet pour tous – nda).
Tu parlais de Nietzsche. Quels sont les penseurs qui t’accompagnent ?
Y’en a quelques-uns. Mais le problème, comme je le dis dans mon échange de mails avec Michel, c’est que ma culture est pas très profonde quoi. Elle reste au stade de curiosité…
Tu picores quoi.
Beaucoup.
Quels penseurs as-tu donc picoré le plus ?
(Rires.) Eh bien c’est sûrement Nietzsche que je connais le mieux.
Il est assez populaire chez les musiciens « rock » !
Oui, parce que c’est assez poétique et que c’est souvent une construction assez brève, par fragments, curieuse. On a du mal à penser que c’est un philosophe et pas un chanteur curieusement.
Nietzsche est presque autant un poète qu’un philosophe en fait.
Oui. Alors après certains tirent une vraie construction à partir de ses écrits et effectivement on peut le faire mais moi ça me paraît plutôt être de l’ordre du Mikado ce qu’il faisait, un Mikado avec des choses très très antagonistes. D’ailleurs une de mes phrases préférées de lui c’est sur la maturité ou de l’immaturité de l’homme, c’est : « Faire les choses avec le sérieux d’un enfant qui joue », ce qui rejoint un peu (sourire) ce que je disais tout à l’heure sur les stratégies enfantines. Tellement qu’on dirait pas une phrase de Nietzsche ! J’aime aussi : « Sans musique la vie serait une erreur », c’est une phrase très rêveuse, je trouve. Enfin pas tellement étayée (rires) !
Oui, c’est comme un aphorisme poétique, ouvert à l’interprétation.
Et je suis aussi un grand fan de quelqu’un qui se répète beaucoup et qui doit pas être extrêmement bien vu, c’est Krishnamurti (prénommé Jiddu, ce philosophe d’origine indienne est né en 1895 et mort en 1986 en Californie et il promu une éducation alternative visant à transformer ce qu’il appelait le « vieux cerveau conditionné de l’homme » afin d’accéder à la liberté – nda)
Qui est-ce ?
C’est un philosophe mystique qui a une drôle d’histoire. Il faut bien le connaître pour savoir ça parce qu’il n’est pas connu pour ça. Au début du XXe siècle, époque assez spiritualiste, y’a eu une espèce de congrégation qui s’appelait l’église théosophique, qui regroupait un peu toutes les religions qui venaient de Russie, des courants de pensée sans doute influencés de Gurdjieff (penseur d’origine arménienne né en 1877 et mort en 1949 qui fut en effet, dixit Wikipedia, une « célèbre figure de l’ésotérisme de la première moitié du 20e siècle » – nda), des mecs comme ça. On est donc un peu dans l’ésotérisme. Et cette congrégation attendait un messie et ils ont élevé un enfant, qui était Krishnamurti, dans la connaissance et tout. Et il devait faire sa déclaration de messie vers 18 ans ou 21 ans (sourire).
Allez, paie ta déclaration de messie !
Héhé, c’était des gens assez renseignés mais un petit peu versés dans la magie aussi. Oui, Gurdjieff doit aussi être issu de ce mouvement un peu curieux qui est évoqué dans Le Matin des Magiciens (livre de Louis Pauwels et Jacques Bergier publié en 1960 qui est une « introduction au réalisme fantastique », et également titre d’une chanson d’Aubert qui figure sur l’album Roc éclair – nda), tout ça. Et quand Krishnamurti a fait sa déclaration, je crois que c’était en Hollande, il a dit que y’avait pas de religions et pas de messie en fait, donc ça a semé la consternation chez les siens (rires) !
C’était une anti-déclaration de messie.
Mais il avait quand même un aspect multi-religieux, une spiritualité très forte basée sur l’attention plutôt que sur la concentration, quelque chose de très ouvert avec un vrai travail sur soi-même et un refus de tous les maîtres. Donc on a beaucoup retranscrit ses discours dans des livres et c’est quelque chose qui tient bien debout quand t’es un petit peu anar et qu’en même temps t’as un peu besoin d’un compagnon. Je pense qu’il doit y avoir des failles, c’est pas comme un système mathématique de pensée, mais je l’aime beaucoup. En plus il y met pas mal de bouddhisme et j’aime beaucoup le bouddhisme évidemment…
Pourquoi « évidemment » ?
Bah parce que y’a rien de mieux (rires) ! A mon avis. Comme Krishnamurti j’aime pas les religions, cet aspect grégaire qui déforme la parole. Quand je vois comment mes interviews sont déformées, j’imagine ce que ça doit être pour la retranscription de la parole des prophètes. C’est compliqué parce que quand t’exprimes quelque chose d’assez compliqué 1) déjà tu l’exprimes peut-être mal et 2) ton interlocuteur est peut-être pas dans le truc donc voilà… !
Il y a un problème de scribe, de média !
Oui, surtout pour le bouddhisme parce qu’en général le bouddhisme c’est pas une question de savoir, c’est quelque chose qui se vit. Donc si le gars te dit : « J’ai vu Dieu » et que tu ne l’as pas vu, ça rend la description compliquée. Tu vas peut-être imaginer un mec barbu parce que toi t’as besoin d’un père mais c’est peut-être pas du tout ce que le gars a voulu dire (rires) ! Et quand tu vois que certaines paroles ont été retranscrites plus de 300 ans après leur prononciation et que t’imagines un peu le nombre d’intermédiaires qu’il y a eu… C’était sans doute des intermédiaires qui n’avaient pas bien compris le message, ou qui n’avait pas voulu le retranscrire correctement. Parce que souvent ces grands prophètes étaient des révolutionnaires, ils ont tous un peu agité leurs pays. Ils étaient aussi des philosophes, leur message avait quelque chose de politique donc… voilà.
Toi, tu dirais donc que tu n’as ni Dieu ni maître ?
Bah comme Dieu n’est justement pas personnifié et que là je suis à peu près certain de mon propos, que je sais qu’il y a pas un mec qui a créé quelque chose (rires) ! Donc non, pas de maître.
Musicalement, est-ce pareil pour toi qui a vécu un certain « âge d’or » de la musique rock ?
Après des anges qui jouent de la musique et qui se sont incarnés, qui ont été vivants, oui, oui, bien sûr. Il y a eu des fulgurances comme Jimi Hendrix. Mais il faut pas forcément mourir jeune parce qu’il y a aussi eu des gens comme Jimmy Page, des groupes comme Les Beatles…
Tu les vois plus comme des anges que comme des dieux ?
Bah oui, parce qu’ils sont habités par la grâce à un moment donné. Et après y’a une construction, y’a une espèce de roue qui se met à tourner. Quand je regarde la façon de travailler des Beatles, j’y vois encore une stratégie enfantine : les gars se retrouvent dans un pavillon de banlieue et en chemin si l’un des gars a pris le taxi et qu’il a discuté avec lui il va dire : « Tiens, essayons de partir de cette phrase… », ce que font tous les groupes. Et c’est ça qui est assez curieux, c’est que c’est toujours quatre mecs qui sont à l’école, quatre mecs qui sont a priori pas plus intelligents que les autres mais qui vont le devenir et devenir de grands influenceurs à force de jouer ensemble. Leur esprit s’ouvre parce qu’ils ont accès à des rencontres, des choses comme ça, et tu finis par avoir Lennon qui dit quand même des choses très intéressantes alors que c’est juste un fils de prolo. Donc voilà, on est toujours dans l’idée de récipient, et ça c’est déjà un peu parler de Dieu. Disons que c’est pas les gens qui se font eux-mêmes, c’est aussi l’environnement, le regard des autres… Quelqu’un qui était laid peut par exemple devenir beau grâce au regard des autres…
Les choses se transforment.
Oui, les choses se transforment. Parce que sinon à la base y’a aucune raison que des petits gars de Liverpool soient plus doués que d’autres. Mais voilà, y’a eu la rencontre avec Brian Epstein (leur manager de 1961 à son décès en 1967 – nda), George Martin (leur producteur de 1962 à 1969 – nda), l’époque et tout d’un coup la drogue donc ils ont eu un outil extraordinaire, ils ont eu les moyens, en commençant comme un boys band, d’arriver à quelque chose d’énorme (rires) !
Très vite d’ailleurs.
Oui, c’est 7 ans la carrière des Beatles. Et Jimi Hendrix 3 ans.
On a tendance à l’oublier cette brièveté. Avec les années 80 on a été habitué à ce qu’un groupe puissent durer 20 ou 30 ans, je pense à U2, REM, Depeche Mode, The Cure, par exemple, et maintenant un groupe sort un album tous les 2-3 ans mais avant c’était plutôt tous les ans voire tous les six mois…
Mais ça arrive souvent que les gens s’essoufflent, à moins de grands changements dans leur vie. Regarde, même Led Zeppelin…
Un groupe c’est une alchimie particulière entre plusieurs musiciens, ça ne dure qu’un temps…
Oui. J’imagine que c’est pareil avec les femmes. Il faut toujours un peu se remettre en danger, c’est peut-être aussi un peu le sens de cet album…
T’avais besoin de te remettre en danger ? Tu sentais que c’était le moment ?
J’ai pas trop réfléchi à ça mais peut-être que les choses qui viennent à moi parlent pour moi. En plus y’a vraiment eu des événements dans ma vie qui montrent ça. Je veux dire, c’est bizarre, parfois tout d’un coup tu prends une décision, tu te dis : « Nan, je vais pas rester là, je vais changer de vie » et cette décision on dirait que tout le monde la lit sur ton front quand tu sors dans la rue. C’est pareil quand tu te dis : « Je vais me chercher une femme », on dirait qu’elles le voient (rires), que c’est écrit. Et quand c’est pas écrit, elles sentent que c’est pas pareil.
Ouais, on dégage ce qu’on pense.
Alors est-ce les phéromones ? Ça peut être beaucoup de choses…
On ne communique pas que par la parole, heureusement.
Un espèce de regard, une manière insistante d’être…
Une énergie, oui. Tout à l’heure tu disais que Houellebecq était la plus grande rencontre que tu avais faite ces dix dernières années. Tu en as fait d’autres des grandes rencontres, tu as rencontré des écrivains, des musiciens, des chanteurs, des poètes… Quelles sont, avant Houellebecq, tes autres grandes rencontres comme ça ?
Bah pour moi une autre grande personne c’était Barbara (ils se sont rencontrés en 96 à l’occasion de Barbara, son dernier album réalisé après 16 ans de silence discographique où il lui a écrit un texte, « Vivant Poème », qu’il chante aussi sur son album Stockholm où elle lui a écrit un texte, « Le jour se lève encore » – nda). Parce que de la même manière on est devenu assez joueurs tous les deux, comme des enfants, et puis on était un peu dans la séduction, quelque chose de très rigolo…
Oui, dans ce genre d’amitié il y a de la séduction. Il faut de la séduction.
Oui, oui, et elle peut être intellectuelle ou même se traduire par un rapprochement physique, même entre hommes hein. Quand par exemple on aime bien se toucher l’épaule. Alors avec Houellebecq c’était un peu : « Putain, il est bizarre ce mec, il a une drôle de gueule ! » Puis : « Ah bah non en fait, j’aime bien ». Autour de moi la gente féminine le craignait aussi énormément et puis petit à petit y’a un charme qui opère. Il est agréable aussi, il est un peu effrayant mais comme dans les contes de fée si tu t’approches mieux du monstre tu découvres un pouvoir magique (rires) !
Je vois. Mais c’est vrai que physiquement il dérange. Sans l’avoir rencontré on peut juger cela en regardant les photos dans la presse, on a l’impression qu’il n’a jamais la même tête quoi.
Oui, oui. Et on sait pas s’il est costaud ou freluquet.
A propos de photo, il y en a une assez particulière dans le livre qui accompagne votre album : on vous voit tous les deux assis sur une chaise avec un champ très automnal derrière vous et vous êtes tellement différents physiquement qu’on a du mal à croire que vous avez le même âge (58 ans). Toi tu dégages encore tenue et vigueur, une belle corpulence, alors que lui dégages quelque chose de très hivernal, dur, vieux…
Mais j’adore, parce qu’on dirait qu’on fait tous les deux une croisière dans le rien ! Et on a l’air ravi. On est ravi d’être dans le rien et de se rencontrer.
Oui, Les Parages du vide…
(Silence.)
En lisant votre correspondance par mails dans le livre de ce disque on apprend que vous avez pas mal parlé de chanson ensemble. Lire ça m’a fait repenser à ce qu’a dit Miossec lors de la promo de son nouvel album, Ici bas, Ici même. Il avançait que : « Les bonnes chansons sont de très mauvaises poésies ».
Oui…
Cette phrase m’est revenue en tête quand j’ai découvert ton nouvel album, parce qu’à l’aune de son jugement je me disais : « Ok, du coup soit Houellebecq est un très mauvais poète soit c’est un très bon chansonnier soit la vraie poésie a basculé du côté de la chanson… »
C’est-à-dire qu’en chanson on laisse passer des choses qu’on laisserait sûrement pas passer en poésie. Mais, grâce à Dieu, Houellebecq écrit souvent en alexandrins avec des rimes riches donc si les mots sont d’aujourd’hui ou si leurs tonalités est d’aujourd’hui, la facture, elle, elle est un peu 19e siècle, et le 19e siècle c’est l’époque où les poèmes étaient faits pour être dits donc, du fait qu’ils étaient faits pour être dits, ils étaient déjà musicaux en soi. C’était des poèmes qu’on lisait à voix haute, alors qu’à partir du surréalisme on a commencé à écrire en prose, à libérer l’inconscient, et là on a commencé à avoir des poèmes compliqués à chanter, des poèmes sans aucune structure…
On a eu des poèmes qui sculptait le blanc de la page, comme Les Calligrammes d’Apollinaire…
Ou le cadavre exquis. Bowie en a fait beaucoup. Mais il les a faits pour la musique…
Oui. Tiens, pour revenir aux grandes rencontres artistiques de ta vie, Bowie c’est quelqu’un que tu as pu rencontrer ?
Moi je dirai que je l’ai rencontré mais je pense pas que lui dirait ça (rires) ! Non, je l’ai juste croisé.
Par contre si j’en crois mes sources tu as vraiment rencontré Lou Reed. A un moment vous avez travaillé ensemble sur une version export d’un disque de Téléphone…
Oui, c’est vieux, c’était à l’époque de Dure Limite (sorti en 1982 et signé chez Virgin, le label de Richard Bronson, parce qu’après trois albums chez Emi le groupe souhaitait tenter de percer aux Etats-Unis, ce quatrième et avant dernier album de Téléphone a bénéficié de la production du réalisateur de The Wall, Bob Ezrin, et Lou Reed a bel et bien tenté d’adapter six morceaux de l’album en anglais pour sa version internationale, mais le résultat n’a pas convaincu – nda)
Et ce disque n’est pas sorti parce que tu n’avais pas aimé ses adaptations…
Oui, on n’y arrivait pas trop. Il me disait toujours : « That’s hippie stuff » (rires) ! Mais il me disait toujours : « C’est bien en français, c’est mieux en français ». C’est un fou de langue française donc ces adaptations ça l’énervait (mais à l’époque il avait sûrement besoin d’argent parce qu’il venait de sortir Rock and Roll Heart, Street Hassle et The Blue Mask, trois disques qui, sans être le suicide commercial de Metal Machine Music, se révélèrent assez déroutants, comme en quête de repères – nda). Mais nous on espérait faire un peu notre trou aux Etats-Unis…
Ça t’a frustré de pas le faire ?
Non, pas du tout. En plus quand je chantais en anglais, surtout des adaptations comme ça, on aurait dit de l’allemand.
Ah ouais ?
Ouais, une histoire d’accent tonique. Alors que quand je reprends des chansons des Stones, je vois à peu près comment ça doit être chanté. Quand je vivais aux Etats-Unis au moment de faire ce disque, des idées commençaient à me venir en anglais, des chansons commençaient à s’écrire en anglais… J’ai une théorie là-dessus. Je suis pas du tout un défenseur de la langue française mais je crois qu’il vaut mieux écrire ce genre de choses dans la langue dans laquelle on rêve parce que dans les mots et dans leur son ou dans l’endroit où tu les as entendus y’a des tenants et des aboutissants qui indiquent une musique et qui indiquent des choses qui vont être très personnelles, et qui t’échappent aussi ! Par exemple, « Crache ton venin » – c’est une anecdote, j’en ai des centaines comme ça – est venu d’un truc comme ça. En fait ma petite sœur avait un poisson rouge et un chat et le chat avait bouffé le poisson rouge donc y’avait la queue qui dépassait de la bouche et ma petite sœur lui courait après en disant : « Crache, crache ! » Et en fait la chanson et la musique sont calquées sur ce cri d’amour pour deux êtres autant aimés l’un que l’autre où fallait que l’un crache l’autre (rires) ! Et là-dedans, dans cette manière de le dire, y’avait quelque chose qui venait du ventre, quelque chose qui était plein de désespoir et plein de volonté, que je trouvais magnifique. Enfin ça c’est une analyse un peu a posteriori mais j’avais trouvé évident que ce mot « crache » contenait l’acte en lui-même puisque si tu dis très fort « crache » bah tu vas cracher quelque chose. Ce qui est génial dans les mots c’est ça, c’est que leur musique évoque leur sens. Ou pas. Quelque fois c’est l’inverse. Tu vas avoir un mot à la sonorité très douce qui va évoquer quelque chose de très dur.
Oui. Justement, quel est ton mot préféré ?
(Silence.) J’aime bien « mésange ». Ouais. C’est un mot qui prête pas vraiment à conséquence, qui veut vouloir dire « moitié ange » et qui désigne des petits animaux qui passent l’hiver tout nu à côté de nous, donc tu leur donnes des petites boules de graisse si t’as le temps. C’est assez courageux. Eux, ils migrent pas. Il reste en France, Monsieur (rires) ! Et quand ils ont le ventre bleu et une petite crête sur la tête, avec le nom, c’est très très joli. Ils vont se planquer dans un trou dans le mur, c’est très joli. Il me semble que j’avais un autre mot récemment. Mais je m’en souviens plus. (Silence.) Les mots ça résonne vachement, et souvent c’est grâce à leurs mélodies qu’on a réussit un peu à faire du rock en français. C’est un peu comme le rap, c’est en pompant les mélodies de la vie quoi, la mélodie colérique, la mélodie précipitée de l’ado qui déblatère plein de mots parce qu’il en a ras-le-cul. D’un coup y’a des rythmes, des intonations… Par exemple : « Voilààà, c’est fini » (il le dit en prenant la même voix chagrin qui a fait le succès du fameux refrain de « Voilà, c’est fini » – nda). Si on l’avait chanté comme un prof de chant aurait dit de le chanter, on aurait fait un « a » ouvert mais cette phrase exprime une petite déception donc tu peux pas chanter : « Voilààà ! » (il fait un « a » ouvert, presque triomphal – nda), t’es obligé de fermer le « a » (il reprend la voix chagrin, qui courbe l’échine), de dire : « Voilààà… ». C’est (timbre apitoyé – nda) : « Ohhh… ohhh… ». Y’a du « o » dans dans ce « a ». Donc voilà c’est en se calant sur la vraie vie qui fait que la mélodie peut tenir la route.
Oui, parce que du coup y’a un effet de réel, c’est humain, incarné. Pour en revenir à l’écriture de Houellebecq, beaucoup de gens – j’en ai rencontré – trouvent qu’il écrit mal, qu’il n’a pas de style… Et c’est marrant d’ailleurs parce que lorsqu’il a sorti son recueil Configuration du dernier rivage, je me rappelle que Le Petit Journal de Canal+ avait réalisé un micro-trottoir pour en soumettre des extraits à des jeunes beaucoup avaient cru que c’était du Booba…
C’est vrai…
Parce qu’il a un art de la punchline aussi, un côté provoc qui caricature son époque…
Oui, mais je trouve pas que ça soit mal écrit… En fait je le vois comme un chansonnier au sens où il se laisse transpercer par des envies de dire, par l’harmonie qu’il trouve dans la phrase, plutôt que par l’envie de te serrer la main en se présentant comme poète.
Oui, et puis c’est assez horrible de se dire ouvertement poète.
Ça c’est horrible. Et quand les mots bousculent ta pensée, ça complique beaucoup de choses hein. C’est compliqué les mots. Regarder le mot « dieu », on est très embêté avec le mot « dieu », avec le mot « amour » aussi. Parce que le verbe « aimer » se conjugue pratiquement à toutes les personnes et à toutes les choses… En poésie, ces grands mots sont souvent convoqués, c’est pour ça que c’est dur de faire de la poésie.
C’est le défi : comment dire quelque chose d’encore substantiel avec des « mots valises »… ?
C’est pareil pour le verbe « croire », parce qu’il signifie à la fois la foi la plus aveugle que l’hésitation, le : « – T’es sûr ? – Non, je crois » Ça fait large pour un mot.
(A SUIVRE.)









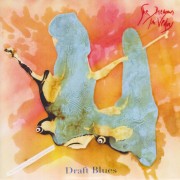
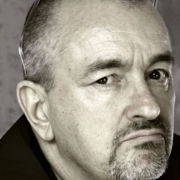

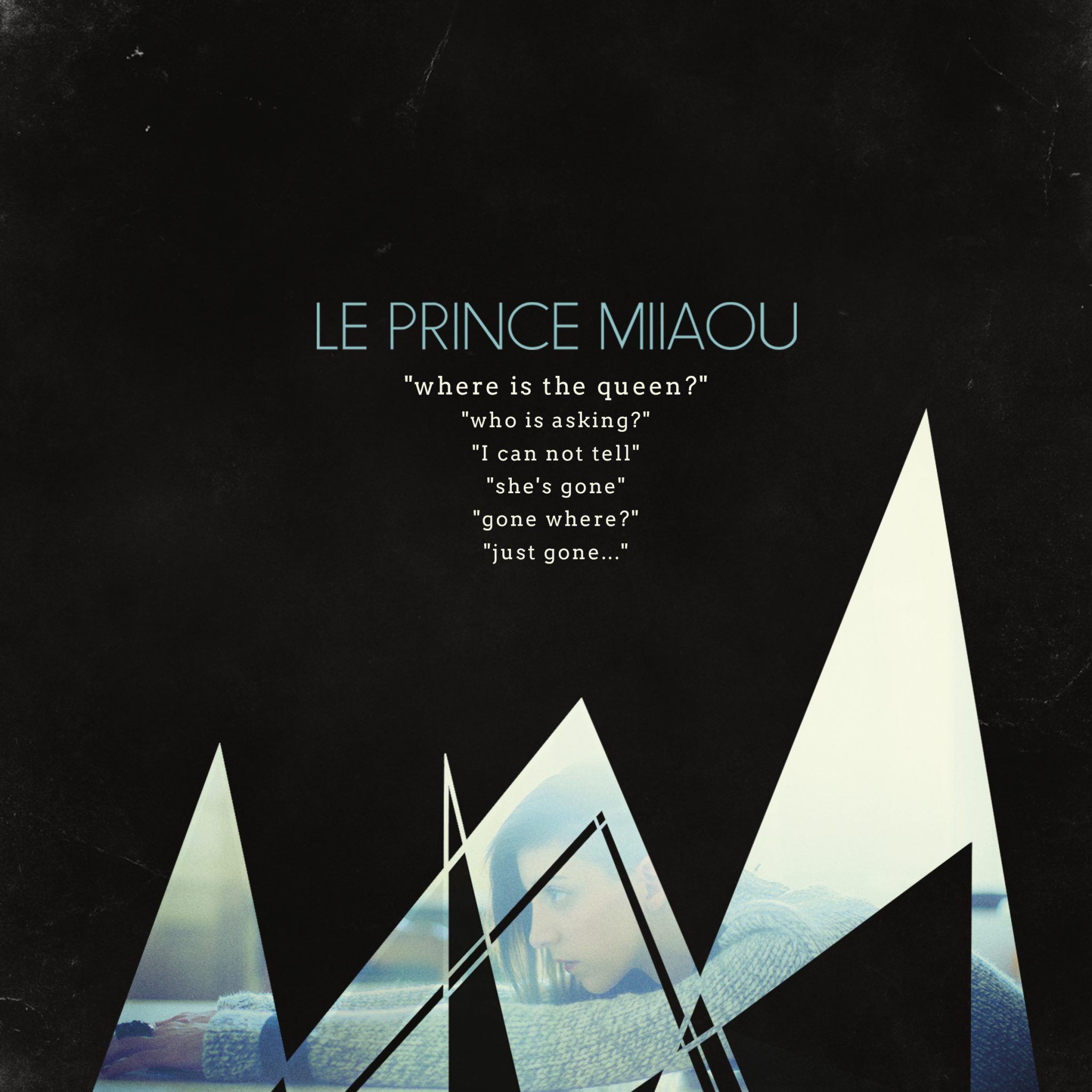

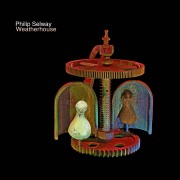


Un marchand de disques m’a dit un jour que Jean-Louis Aubert était le Mick Jagger du pauvre.
Cette considération stupide ne m’a bizarrement jamais quitté.
En tout cas cette interview est très intéressante, si ce n’est parce que la collaboration JLA/MH intrigue les braves gens, au moins parce que une icone de la culture populaire dit des choses au sujet de notre manie de barbouiller le réel de nos expectatives intérieures.
J’aime pas trop ce genre de remarque, « le Mick Jagger du pauvre », ça sent l’autoflagellation française. l’Amérique c’est l’Amérique et la France c’est la France, le rock le rock et la chanson la chanson, Jagger Jagger et Aubert Aubert. Tu vois ? Les deux c’est bien. En tous moi j’aime les deux !
Tout comme la partie numero 1, cette retranscription est vraiment passionnante, dans le sens où on sent que l’intervieweur/écouteur/rebondisseur é c o u t e , est plus qu’attentif à ce que M. Aubert dit , et développe …
Ajouté à ça que vous n’avez pas tranché-charcuté-condensé-édulcoré les réponses( ce qui devient systématique …’ailleurs’ ) , on a là un échange précieux , qui rend compte de la pensée-en-mouvement , qui rend compte de la complexité du Conteur…
et…
et pour la peine, c’est un tel plaisir que de vous lire, Sylvain , qu’on vous excuserait presque d’orthographier Corine avec deux ‘n’, de croire que Richard K. a cessé de jouer avec JLA après Téléphone =o} …et on vous passerait presque votre mauvaise foi ;oP,consistant à prétendre qu’il n’y a que deux ou trois chansons à sauver sur les albums solo de l’artiste 3o} !!!
Justement , si vous avez trouvé du charme à ‘Stockholm’, et à ses partis-pris, ses ‘risques’, ses ‘atypismes’=o} , vous devriez reposer une oreille(les deux!) sur les premiers opus d’Aubert , qui sont truffées de pépites ,un peu noyées parfois peut-être par la production,mais d’authentiques petits bijoux , discrets et ‘non-single-isables’,suffisament magiques pour accompagner looooongtemps l’auditeur … des chansons ‘ouvertes’, et très évocatrices ,à multiples sens… qui accompagnent , qui évoluent …qui mouvement-isent ! , comme la vie =o>
Bonjour Lylian,
Ton message est tellement sympathique que je t’excuserai presque de m’accuser de mauvaise foi ahahah 😉
Merci pour l’histoire du double N, je viens de corriger cela.
Du reste que (te) dire ?
Je peux te tutoyer ?
Non, bien sûr que je sais que Kolinka a continuer à jouer avec Aubert après Téléphone.
J’ai un peu schématiser le truc oui.
On a beau vouloir rendre la complexité des choses, dans toutes ses nuances, pour tracer une trajectoire, la faire comprendre, faut parfois faire l’économie de certains détails, surtout si on n’écrit pas une biographie sur 200 pages 😉
Je suis d’accord, y’a de bonnes chansons sur les disques solos d’Aubert, parfois avec une prod pas top, surtout ses deux premiers albums des années 80… mais je pouvais pas toutes les citer, à part les morceaux tubesques, et là oui y’en a toujours au moins 2-3 par disque.