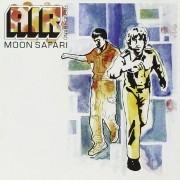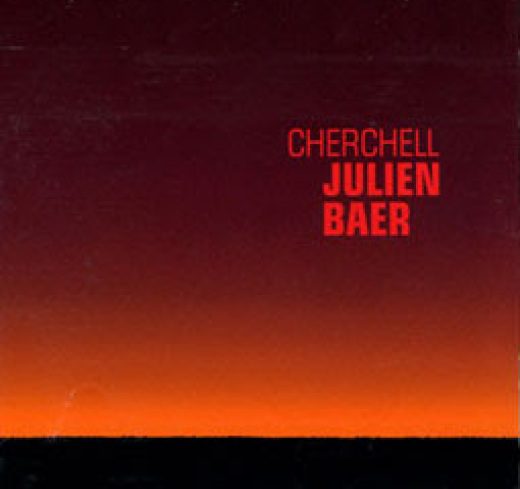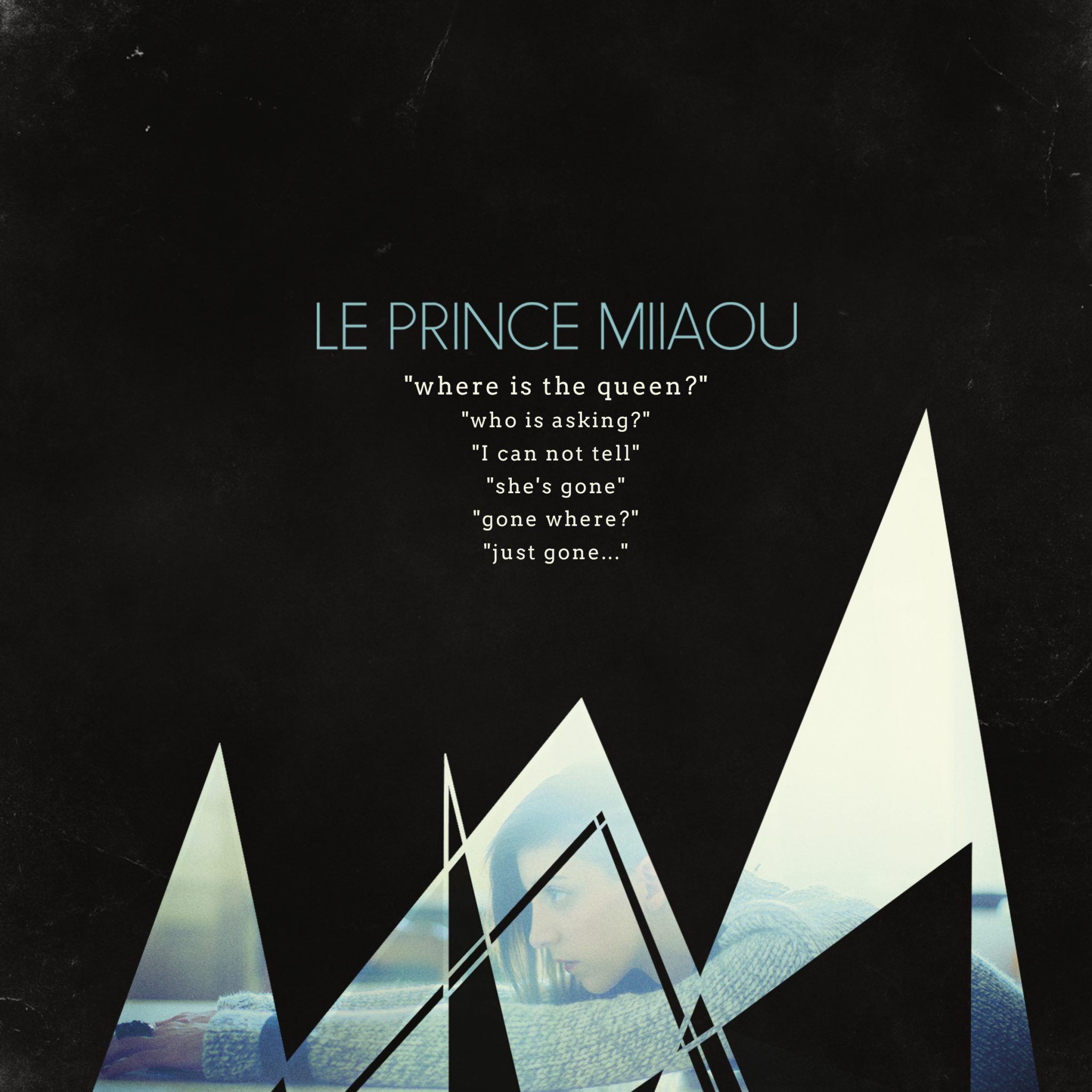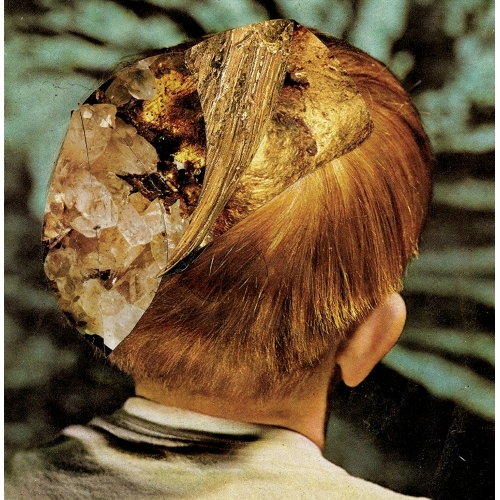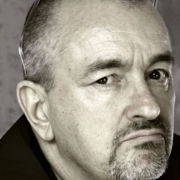Jean-Louis Murat : Babel (1)
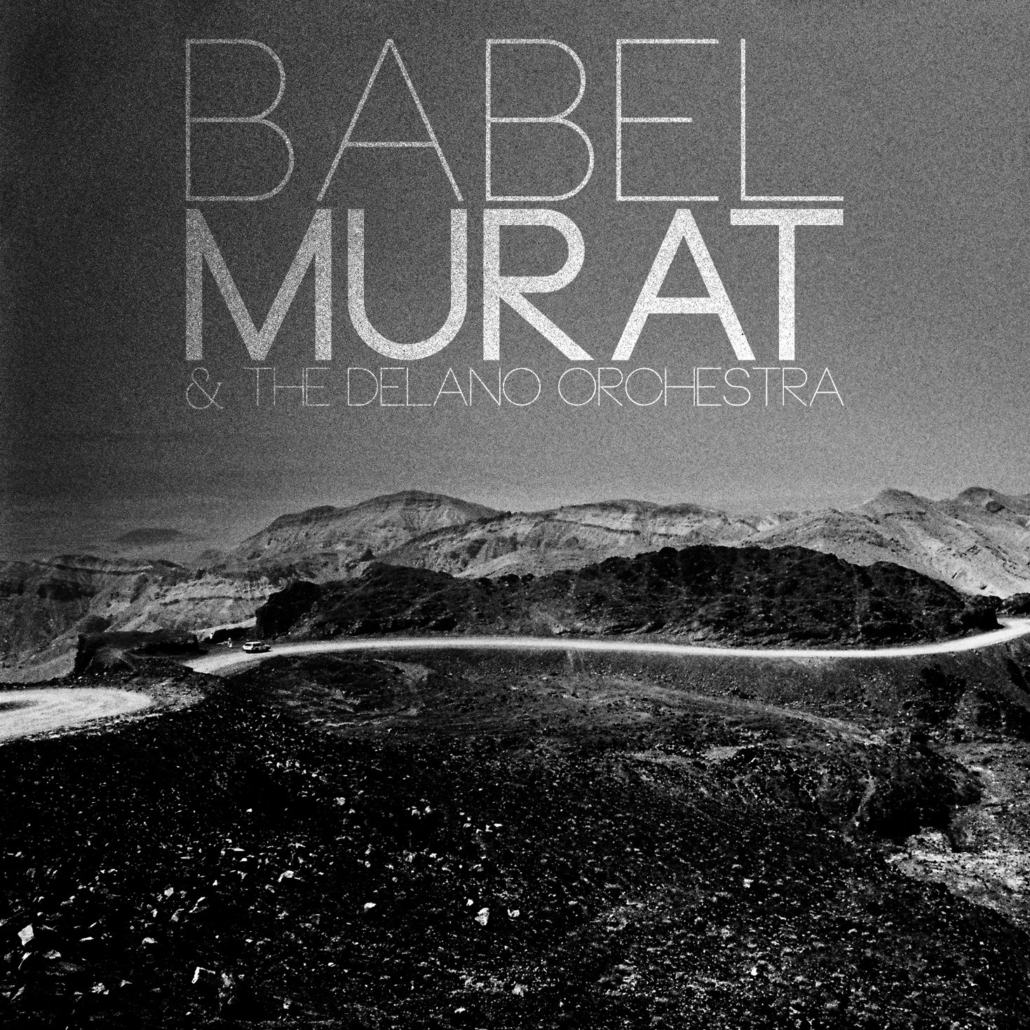
17 septembre 2014. 16h20. « Moi je vouvoie que les filles ». D’emblée Jean-Louis Bergheaud appose sa signature de séducteur old school (pléonasme), à moins que ce ne soit celle de Jean-Louis Murat du coup, la manière du premier de se draper illico du velours vaguement macho du personnage qu’est le second. Pour se protéger et jeter quelque chose en pâture ? Tester la perspicacité de son interlocuteur ? Mystère. « Moi j’aime varier entre le vous et le tu en fait. C’est une question d’usage à bon escient. Par exemple, des fois, une fille, faut la tutoyer. » « Vous revoulez un truc à boire, Jean-Louis ?», demande sur ces entrefaites l’attachée de presse partie raccompagner le précédent journaliste. « Ouais, si tu bois quelque chose ».
Une voix dit : « Merci, je vais rester au Perrier ». Et là, voyez-vous, c’est le drame. Parce que cette voix c’est la mienne et la question ne m’était pas adressée. « Mais nan voyons, j’étais en train de passer du vous au tu ! Ahhh, ça y est, il m’a ruiné mon effet. Ahhh, putain, il est lent ! Il est lent, je crois que ça va être dur l’interview. Il est super lent ! » Ah, la, la, c’est toujours comme ça avec Murat, il ne peut jamais s’empêcher de cabotiner quand le journaliste est un homme et que l’attachée de presse est une femme. Histoire de rappeler – dans un sourire –mais de rappeler quand même, qui est le mâle alpha. Bref, de faire l’Artiste, pour qui les journalistes – et l’exercice de la promo – seront toujours quelque chose de « pouah ».
Déjà la dernière fois, il m’avait mêlé à un pareil spectacle. C’était il y a trois ans pour la sortie de Grand Lièvre (la première fois que je l’interviewais) et c’était déjà dans cette rue. Y réside l’hôtel qu’il réserve à chacune de ses venues promo à Paris. A la faveur d’un ciel vaguement ensoleillé et sur les conseils du label, nous sommes en terrasse. Ca fait balade au grand air, entente cordiale. Mais lui préférerai être dans sa chambre. « C’est un truc de citadin de se foutre dehors au moindre rayon de soleil, d’être esclave de ce machin. » Ah, les citadins, même cible que les journalistes… Un chat vient se frotter à notre table. « C’est un mâle, s’avise-t-il de préciser. Il va tout attraper, même les petits lapins, ça sert à rien… »
Murat lui-même essaye de tout attraper. Si dans les années 90, lit de ses pièces maitresses que sont Cheyenne Autumn, Le Manteau de pluie, Vénus, Dolorès, Mustango, il sortait un disque tous les 2-3 ans, au tournant des années 2000, à partir de Lilith, double-album de 2003, son rythme s’est accru à un tous les deux ans voire un tous les ans. Tout ceci à mesure que ses ventes ont chuté et qu’il n’a plus pu faire le jeune premier qui pleurniche et fait mouiller. Seconde rencontre donc en ce qui nous concerne. Autour de Babel, son album de 2014. Interview originellement pour Philomag. Plus que d’habitude nous n’allons donc pas seulement parler de musique. « Oui, on se tutoie si tu veux, en plus ça va plus vite ».
« quelque part pour moi tout ça n’est qu’une sorte de pis-aller »

Bonjour Jean-Louis, ton nouvel album, Babel,est donc un double album, mais ce n’est pas ton premier. En 2003 Lilith en était déjà un…
Ouais.
En quoi dirais-tu que ce nouveau double diffère dans son processus et son résultat ?
(Silence.) En rien. C’est assez semblable. Je l’ai fait très rapidement, sans savoir au départ que ce serait un double album.
Vu le titre du disque qui évoque une certaine grandeur, un foisonnement, j’avais pensé que tu avais initialement prévu que ce soit un double album…
Non, non, c’est plutôt le fruit du travail. Comme les sessions se passaient bien on a continué à bosser (avec le The Delano Orchestra avec qui il a enregistré ce disque) et vu qu’à la fin ça tenait pas sur un album on en a fait un double.
Oui, parce que y’a quoi ? En tout quasiment 1h50 de musique ?
Ouais, 1h40 je crois.
Et ça ne t’a pas fait peur de sortir un double album ?
Non, de quoi veux-tu que j’ai peur ?
Hé bien ce n’est pas tout le temps le meilleur format pour mettre en avant certaines chansons et c’est parfois c’est trop copieux pour que le public s’en saisisse vraiment…
Ah ça, ça ne me préoccupe pas, non. Je m’en fous.
Comment t’y es-tu pris pour répartir ces 20 morceaux sur deux disques ?
Au départ j’étais un peu sur l’idée d’un ici et d’un là-bas, mais j’ai fini par trouver que c’était con, trop schématique, et donc j’ai tout mélangé. Au hasard. A l’hasard j’ai tout mélangé.
Le second disque m’a donné le sentiment d’être plus calme, plus posé…
C’est ce qu’on me dit, ouais. Je sais pas, c’est le hasard ça aussi.
Tu es prolifique. Depuis tes débuts discographiques en 81 tu as sorti un nombre croissant d’albums. Babel est à ce titre ton 16e disque studio. Artistiquement de quoi n’as-tu pas encore accouché ?
Hummm, moi j’ai jamais voulu être chanteur hein. J’aurais plutôt voulu être écrivain. Donc quelque part je suis loin de mon idéal et tout ça c’est une sorte de pis-aller pour moi.
C’est toujours ton idéal ?
Non, maintenant je me dis que j’ai le souffle un peu trop court pour être écrivain, ce qui me va bien c’est des rushs de 3-4 minutes.
Et qu’il faut bien que le corps exulte ?
Ouais.
Mais tu aurais pu faire du fractionné pour écrire des romans, coucher quelques pages ou un chapitre par jour…
Nan. La chanson ça me va bien finalement.
Tu n’en es jamais lassé ?
Oh non, c’est un plaisir qui se renouvelle tout le temps. A chaque fois je me dis : « Tu vas bien finir par en avoir marre ? » et en fait : « Non. » Jamais.
Jamais ?
Non, je me retrouve toujours dans le même état d’innocence qui était le mien lors de l’écriture de ma première chanson.
Dans « Long John », un de tes nouveaux morceaux, tu chantes : « Neil / Quittons cet exil / Que me font / Les chansons »…
Ouais (le chat fait son retour : « Toi, sale bête, tu dégages ! »)…
Ecrire des chansons c’est être en situation d’exil ou en chercher un ?
(Silence. Il continue de lui faire la guerre.)
Tu n’aimes pas les chats ?!
Si, j’en ai. Mais celui-là, il me plait pas. Humm… L’exil ? Oh bah c’est surtout dans le rapport avec les paysans de chez moi, tout ça, pfff…. Des fois, si je vais boire un coup, c’est : « Alors, le chanteur, comment il va ? On te voit plus à la télé, dis ?Et Drucker, il est comment alors ? Et Mylène Farmer ? Hein ? Putain, métier de feignant la chanson ! » Donc j’ai l’habitude.
Alors que faire des chansons ce n’est pas de tout repos et peut même être une activité très artisanale…
Ouais, c’est ça, mais nan, pour les paysans c’est un truc de feignants, pfff : « Ah putain, ça va pas vous fatiguer ça ! De toute façon, moi je comprends rien, ça a l’air joli mais je comprends rien à ce que vous chantez… » Ils sont comme ça les gars (sourire).
Pourtant si on peut dire une chose c’est que tes textes sont de plus en plus explicites, moins abstraits, plus direct…
Ouais. Mais pas pour les paysans hein. Et ça, ça finit par te donne une sorte d’étrangeté par rapport au milieu dans lequel je vis, une sorte d’étrangeté où je me dis : « Pfff, c’est quand même malheureux de chanter des trucs où les gens que tu connais et que t’aimes bien, ils comprennent que couic. » C’est un peu gênant.
C’est quelque chose qui peux influencer ton écriture ça, l’incompréhension des paysans et des gens de ton village ? Ça peut être gênant à ce point-là ?
Non, non ! Pas ça, non, non, non, non, mais j’aimerais bien… Y’en a qui me disent…. En fait, les femmes de paysans elles sont plus réceptives. Les femmes, ouais. Mais alors les mecs, c’est : « Putain, j’ai rien compris ! J’ai écouté pourtant ! Mais alors là, pfiouuu ! Faut avoir fait des études pour comprendre ! » Ils sont comme ça (rires) !
Ok. Parlons des jeunes. Quel serait ton moyen pour corrompre la jeunesse ?
Latin et grec obligatoires.
Ah ouais ?
Ouais.
Pour renouer avec le français, la lecture, les racines de la langue ?
Ouais. Et comme ça ils se remettraient au patois, tu vois, ou à l’occitan. Du coup ils feraient ces langues qui sont une sorte de latin. (La serveuse arrive avec le cocktail que l’attachée de presse a choisi pour lui. Jean-Louis : « Merci beaucoup ! » Elle : « Je vous en prie. » Lui : « C’est de la tisane ?! » Elle : « Spéciale touriste. » Lui, renchérissant sur le ton complice : « Merci pour la tisane, je vous remercie ! ») Tiens, par exemple j’ai une chanson qui s’appelle « Mujade ribe » et en patois ça veut dire : « L’orage arrive ».
Oui, je me suis demandé ce que ça voulait dire. C’est une expression que tu emploies ?
Moi, le patois je le comprends et je le parle, mais je trouve plus grand monde à qui le parler. Mais quand j’étais petit, on parlait le patois tout le temps. (L’attachée de presse revient : « Alors ce cocktail, ça vous va ?» Lui : Oui, c’est bon hein ! »)

Quel est ton mot favori ?
Pfff, un mot favori ? Au quotidien je dis plutôt – et je le sais parce que je vois que mes enfants l’utilisent un peu – des mots patois comme : « Webe ? A bu ? Ebe ? Ebe ga ? »
Ce qui veut dire ?
Eh bah alors ? J’aurais jamais cru voir ça ! C’est quoi ce truc ? Les enfants, j’ai prévu de leur apprendre une expression en patois par semaine. Parce que je vois bien que sinon après moi personne ne parlera le patois.
Et comment réagissent-ils ? Ça marche ?
Oui, ils font pareil hein. Mon petit garçon, il est trop rigolo. Par exemple, quand je l’emmène au bois, j’allume un feu et j’utilise souvent des expressions en patois quand je fais ça. Et hop, lui il capte ça. Je le sais parce que l’autre fois j’avais des copains à la maison et ça les faisait rigoler car ils l’entendaient réagir patois : « Webe ? Webe ? » (rires) !
Contrairement au français, très articulé, le patois a ce côté pâte molle onomatopesque, cette glossolalie à la « Awopbobaloobob… » qui pourrait bien se prêter au rock…
Ah oui, sûrement. C’est ce côté bref, très succinct. Par exemple « Bop, bop ! », ça veut dire : « Laisse tomber, c’est rien » et ça, ça marcherait bien (rires) ! « Bob, bob ! »
Quels sont les penseurs qui t’accompagnent ? Et ceux qui t’accompagnent aujourd’hui sont-ils différents de ceux qui t’accompagnaient jadis ?
Alors là j’en parle souvent parce que je suis en promo et que je suis en plein dans son livre, que je lis et relis parce que je trouve ça super et dans ces cas-là, j’ai déjà dû te dire ça, je me comporte en étudiant ! C’est L’Obsolescence de l’homme de Günther Anders. Et évidemment j’en ai entendu parler par Onfray. Et donc voilà, en ce moment je passe mon temps à le lire. Là je vais reprendre le train et j’ai qu’une hâte c’est de replonger dedans. Pour moi qui aimais bien Philippe Muray, des gens comme ça, d’un coup c’est une révélation, Philippe Muray puissance 10. Par exemple j’avais lu L’Homme unidimensionnel de Herbert Marcuse et aujourd’hui je vois que tout était déjà chez Günther Anders. Il est mort en 80, quelque chose comme ça (philosophe, journaliste et essayiste allemand né en 1902 et mort en 1992). Il a été l’amant d’Hannah Arendt, élève de Heidegger, tout ç. Il a eu une vie assez incroyable. Il est parti aux Etats-Unis pour échapper au régime Nazi et après aux Etats-Unis il a un peu tout fait, quoi. J’ai vu que ça avait mis du temps à être traduit en français (celle du premier tome, daté de 1956 et sous-titré « Sur l’âme à l’époque de la deuxième révolution industrielle », ne l’a été qu’en 2002 et celle du second tome, daté de 1980 et sous-titré « Sur la destruction de la vie à l’époque de la troisième révolution industrielle », en 2011). En fait Sartre avait lu le livre en allemand à l’époque et il en avait interdit la traduction. Tu m’étonnes, je comprends pourquoi : toutes ses meilleures pensées sont déjà là chez Günther Anders. Je suis sidéré de voir combien d’années on peut bloquer une traduction ! Günther Anders dit tout ce que Sartre a dit mais en beaucoup mieux. C’est d’une clarté formidable. Günther Anders, tu regarderas. Très, très bien, vraiment, L’Obsolescence de l’homme, admirable. Çaa disqualifié d’un coup beaucoup d’auteurs que j’aimais beaucoup.
Comme qui alors, à part Philippe Muray ?
Hé bien je te dirai presque : Houellebecq. Houellebecq c’est déjà aussi dans Günther Anders. On est dans les années 50 et il décrit déjà ce que Houellebecq raconte depuis le milieu des années 90. Et il écrit ça avec une telle perspicacité. Que ce soit la radio, la télévision, il a tout juste. Tout juste. Et, comme je te disais, dans L’Homme unidimensionnel de Marcuse y’a aussi des choses de Anders. Et effectivement Marcuse l’a connu, il l’a lu et côtoyé. Bref, il s’est pas fait chier Marcuse (philosophe et sociologue marxiste américain né en 1898 à Berlin) ! Sauf que Marcuse est resté communiste, c’est ça la connerie de L’Homme unidimensionnel, c’est que Marcuse trouve vraiment génial le régime qu’a Moscou. Mais abruti, t’as qu’à y aller ! Mais nan, il a continué à se la couler douce en Californie. Ça, ça le disqualifie. Alors que Anders il sait vraiment de quoi il parle. Ouais. Admirable. Surtout ce que j’aime beaucoup chez lui c’est qu’il est pour l’exagération. Et donc il exagère.
C’est-à-dire ?
Bah il dit : « Faut exagérer. » Son postulat c’est que si on n’exagère pas on ne comprend rien. Donc il grossit le trait et tu te t’aperçois que cette exagération lui a fait traverser les décennies car son trait exagéré à l’époque est devenu aujourd’hui un trait normal. Vraiment, formidable, le mec. J’ai hâte de lire beaucoup de choses et d’en savoir plus sur lui.
Récemment j’ai eu cette impression en lisant un court essai de Paul Valéry qui s’intitule Le Bilan de l’intelligence. Tu l’as lu ?
Nan.
C’est un livre qui a été publié en 2011 et qui est basé sur une conférence qu’il a donnée en 1935. Ce qu’il y décrit était peut-être un peu exagéré à l’époque, un peu schématique, mais ça prend justement toute son incandescence aujourd’hui, c’est sidérant.
Voilà, et c’est pareil avec Anders. Anders c’est le premier écrivain écolo absolu, quoi. Il dit que ce qui est bon pour la nature c’est ça le bien et que ce qui est mauvais pour la nature c’est ça le mal. Il prône presque l’assassinat politique. C’est-à-dire que pour lui tu vas chez les mecs de Esso, Total, Mobil et paf, tu les dessoudes. Il en arrive à ça en exagérant. Il a dit et imaginé ça dès les années 50 et tu le crois pas quoi. Tu le crois pas. Et donc à propos de l’obsolescence de l’homme à un moment il voit le truc venir et il dit : « Là, il va falloir lancer l’engineering de l’humanité : le human engineering ». La traduction a laissé l’expression en anglais. « Il va falloir lancer le human engineering sinon l’homme ne pourra plus supporter ce qui s’annonce et dans l’attente de cette ingénierie, en l’état, l’homme est rendu obsolète. » On commence à être là-dedans. Même moi, en chantant et tout, je me sens un peu obsolète. On se sent un peu, pas vraiment dans son époque. L’époque nous disqualifie quoi. Dans Günther Anders tu as ça. Tu comprends tous les processus de l’époque pour nous disqualifier.
(SUITE ET FIN.)