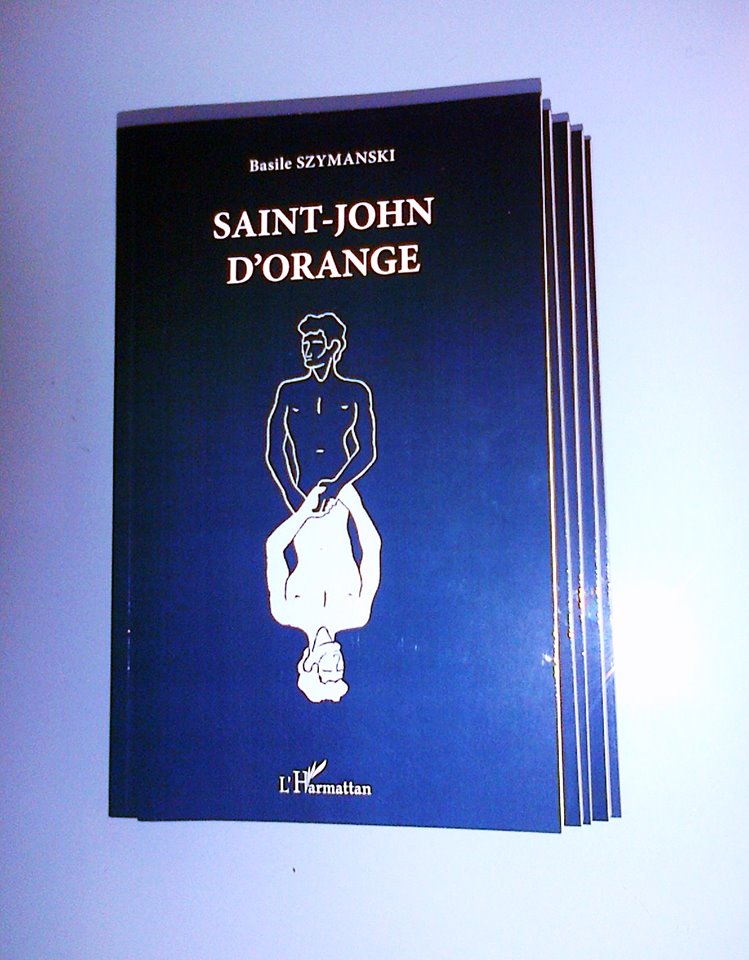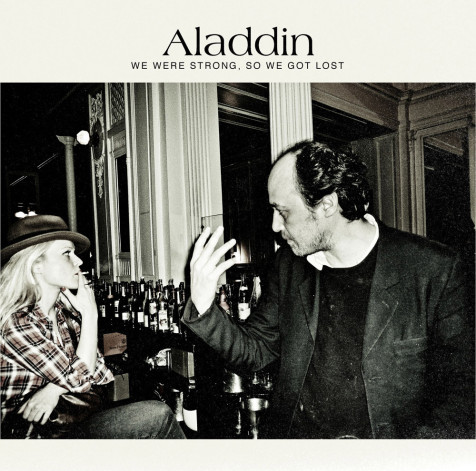BASILE DI MANSKI (2)
8 juillet 2013. 18h « Quand j’écoute MGMT, je me sens intelligent, sensible, courageux. Il y a quelque chose de mystique chez eux. », précise Basile Di Manski à propos du duo de Brooklyn alors que je procède par mail à sa toute première interview. Intelligent, sensible, courageux, je me sens aussi quand j’écoute sa musique. Elle a quelque chose de mystique qui me rend cool. Ce n’est pas écrit sur FB mais depuis 2 ans je vis en couple avec elle.
Elle me fait planer. Je me rappelle de lui avoir dit un jour. Je marchais tout seul dans Paris vers la Seine, je l’avais dans la tête, sur mes lèvres et je le lui ai écrit : « Tu voyages dans ma tête et sur mes lèvres / Comme un coin d’oreiller frais, un rêve / Charrie mes joies et mes peines / Donne du rythme à mon corps et de la grâce à mes gestes / Triomphe de la ville comme un joint que j’aurais toujours aux lèvres / Une sœur, un frère, invisible… ».
D’autres déclarations de ce genre suivront. « La vieille branche qui cède fait plus de bruit que le bourgeon plein de sève mais le bourgeon n’en est pas moins le soleil d’aujourd’hui et de demain » lui écrirai-je, par exemple, après la mise en ligne du premier volet de son entretien (Lou Reed venant de mourir, on le réécoutait plutôt qu’on ne la découvrait elle). Moi, elle me parle. Elle m’accompagne, c’est ma compagne. I cherish the love we have.
C’est la dope parfaite pour le journaliste musical en quête de Rimbaud (warrior) pour être Verlaine (poète), « la mer allée. Avec le soleil. » Pour ça que je me sens si cool avec elle. Car un truc étrange se produit : « la gorge de l’un et le bras de l’autre forment ensemble un corps hybride » dans le prisme de l’« association Dieu-héros-rhapsode » comme le dit Sloterdijk dans Colère et Temps. Un « nouveau corps amoureux ». Alors je swim moi.
Dans Belle de jour, il est dit du personnage de Deneuve que c’est une perle, vous voyez ? Tout ça pour dire à mots couverts… vous voyez ? Je ne dirai donc pas que ce type est une perle, mais sa pop oui, assurément. On peut y slider partout, on se sent super bien dedans. Elle est plurielle, à la fois triste et gaie, rythmique et fluide, old school et actuelle, sainte et seuf… Un peu comme lui, oui, Basile, warrior et princesse. Musicien poète. Peau être.
Oui, peau être, celui qui n’a pour maison que le ciel au-dessus sa tête, cette princesse qui se cherche lui-même (toujours plus séduisante dans tes rêves, toujours). Et fine comme elle est cette muse guerrière (comme une feuille de papier), la plus belle pop musique lui tombe dessus. Fine comme elle est, pas étonnant que parfois la feuille craque, se décolle, crie famine. La musique, la poésie, quelle plus belle aventure dans nos vies marteaux ?
En l’absence d’Amour (Femme in !), je vis sa pop comme une histoire d’amour, héroïque. Comme le sont certaines amitiés. Pour moi, ce n’est pas un talent prometteur comme on l’entend trop souvent dire sur un ton paternaliste des jeunes gens de son âge, pour mieux les destituer, les renvoyer à de chères études néfastes. Non, c’est un talent en pleine possession de ses moyens. Je suis donc heureux d’être le premier à m’en faire l’écho. Passer par là.
Nous étions en train de slalomer track by track dans le répertoire des deux maquettes solo qu’il m’a envoyées depuis les deux ans qu’on se connait. Il nous reste plein de morceaux à évoquer, comme des cadeaux à déballer, tremplins pour vol planer. Plein avant d’en venir à la sortie, le 2 novembre, de son premier livre, Saint-John D’Orange, et des pop song(e)s « Forever After » de son premier vrai groupe Colony (de vacances ?). Back in tongues.
« Je me suis toujours senti super amoureux, mais amoureux de personne, tu vois ? »
Basile, tu parles de banlieue, de quelle banlieue viens-tu et en quoi était-elle artistiquement stimulante ? La musique fut-elle d’ailleurs ta première passion ?
Je suis né à Levallois et j’ai grandi à Asnières. J’aurais beaucoup de choses à dire sur la banlieue et sur l’influence que cet environnement a pu avoir sur mon parcours artistique. Tout petit, j’aimais surtout tout ce qui était visuel. C’est par là que tout a commencé pour moi. Je dessinais tout le temps, je faisais des bandes dessinées. J’inventais des personnages invraisemblables. Je faisais des mini-films avec des figurines animées en stop-motion. Je fabriquais des maisons de poupées… C’était mes premières activités artistiques. Après, il y a eu le skateboard, j’en ai fait pendant des années, je ne pensais qu’à ça et ça a été une expérience énorme – aujourd’hui encore, j’ai du mal à expliquer pourquoi. Un morceau comme « Skateboarding in Slow Motion » parle de ça… Il y avait quelques chose d’utopique dans le mode de vie qu’on avait, comme dans le monde de l’enfance en règle générale. On ne vivait que pour ça, on était très libre et si tu n’avais pas peur et que tu étais un peu doué, ton quotidien changeait de manière assez radicale. C’était l’intrusion d’un truc fantastique dans la ville de tous les jours. Comme dans la musique, les valeurs suprêmes étaient le style et le talent. La beauté aussi, c’était quelque chose de primordial. Les groupes qui se formaient pendant les sessions à la Défense ou au Palais de Tokyo étaient très intéressants. On avait 9-10 ans et on traînait parfois avec des mecs de 20-25 qui nous parlaient d’égal à égal. C’était une communauté très forte. Après, on a toujours tendance à ériger en paradis ce qui est perdu donc j’en rajoute sans doute un peu mais voilà… Ce n’est qu’après que j’ai commencé à jouer de la guitare, à jouer dans un groupe, et peu à peu la musique a remplacé tout le reste. Ce qui est étonnant, quand je regarde en arrière, c’est que d’un côté ces activités me paraissent décousues, mais d’un autre côté je sais que je cherchais la même chose depuis le début. Que ce soit le dessin, le skateboard, la musique ou l’écriture : tout avait le même but. J’ai toujours vécu avec un sentiment étrange, hyper envahissant et un peu abstrait, comme si j’étais raide dingue amoureux, mais amoureux de personne, tu vois ? Un sentiment qui était là et auquel il fallait absolument que je trouve un but, une direction.
Je vois. Plage 7 tu dédies un morceau « To Lord Byron », qu’on évoquait tout à l’heure. Pourquoi un morceau pour et sur ce poète ? Est-ce justement une déclaration d’amour à personne, absolue ?
J’ai écrit « To Lord Byron » parce que c’est l’un des seuls poètes dont je puisse dire que je le connais bien. Je sais qu’il est né en 1788, mort en 1824. C’est pour moi l’archétype de la rock star poétique. J’aimais aussi l’idée de réactualiser l’un de ses poèmes (Le Pèlerinage de Childe Harold, publié entre 1812 et 1818 – nda) sur un beat pour en faire quelque chose d’électronique. Après, ce morceau a déjà 4 ou 5 ans… Il ne m’appartient plus. Et mon intérêt pour Byron a beaucoup diminué.
Je ne sais pas de quoi parle ce morceau-poème mais il s’achève sur un trip « carnaval Brésilien » voire « dance Ibiza » étonnement décomplexé…
Byron aurait adoré les after sur la plage.
Et c’était quoi le rock que tu écoutais beaucoup à 14-15 ans ?
Comme j’ai construis une partie de ma culture musicale en apprenant la guitare, c’est très classique de ce point de vue là : j’adorais Hendrix, Led Zeppelin, tout le rock des années 70. Pendant 1 an ou 2, j’ai appris des solos interminables à la note près. Des morceaux de Santana, de Van Halen. Puis mon amour pour la guitare a pris un coup fatal le jour où un pote m’a fait écouter The Upper Cuts, d’Alan Braxe et Fred Falke. Cet album est parfait, j’en garde un souvenir ultra futuriste. Un mouvement s’est amorcé immédiatement : je me suis détaché de l’instrument pour m’intéresser aux chansons. Ça a été un vrai changement de perspective – je suis passé du micro au macro en quelque sorte…
En parlant de chanson et de changement de perspectives, plage 8 on a « Planes » et celle-là, j’ai le sentiment qu’elle est un peu à part dans ton répertoire. Elle a l’air toute simple, folk, guitare-voix, elle pourrait même être chiante, comme toutes les chansons nues comme ça mais pas du tout, c’est tout le contraire, il y a un truc très entêtant et renversant dans ce morceau et sa mélancolie, il y a quelque chose qui slape et accroche irrémédiablement. Comme un fil lyrique, un truc d’âme qui tient de l’évidence, qui prend par la main et culmine dans la saudade du refrain (« I don’t work to work and I don’t want to die / I just want to hold your hand and it’s summertime »), des paroles ultimes comme peuvent l’être, dans un tout autre genre, celles qui ouvrent Unknown Pleasure de Joy Division (« I’ve been waiting for a guide to come and take me by the hand / Could these sensations make me feel the pleasures of a normal man ? »). Tu t’en rends compte ?
Oui, il s’est clairement passé quelque chose de rare avec « Planes ». Pour moi, ça relève presque du miracle. Ça tient sûrement au fait qu’au moment où je l’ai écrit, j’étais en plein dans une de ces histoires torrides et un peu tristes qui dopent la créativité ! Si elle semble aussi évidente à l’écoute, c’est que sa création a été parfaitement fluide. Ça ne m’était jamais arrivé (sauf peut-être avec « Valium Years ») et ça n’arrivera peut-être plus jamais. Une nuit, à la campagne, je me suis installé dans la vieille Mazda de mon père avec ma guitare en me disant : « Je ne sortirai de la voiture qu’une fois que j’aurai écrit un vrai titre. » J’y ai passé 5h, peut-être 6, et à la fin il y a eu « Planes ». La chanson s’est faite toute seule, c’était incroyable. En partant des deux accords du couplet, j’ai trouvé un flow, je suis rentré en transe et le pont, le refrain, tout est venu sans aucune interruption. C’est une chanson de surf, qui monde et descend, mais ne s’arrête jamais. Les paroles aussi sont venues toutes seules, comme en écriture automatique, c’est peut-être ce qui leur donne le côté « ultime » dont tu parles. Cette chanson est un premier jet total, elle est primitive quelque part… Là encore, je ne suis pas sûr d’être responsable de ce qui s’est passé. C’est arrivé, voilà tout. Quelque chose s’est mis à parler, quelque chose de lointain. Moi, j’étais juste disponible à ce moment-là, dans l’état adéquat.
Plage 9, dans un autre genre, plus rapé, produit, tu envoies un autre morceau que je trouve important dans ton répertoire, c’est « Less Than Zero ». Le sens-tu comme ça et le titre est-il un clin d’œil au livre du même nom de Bret Easton Ellis ?
Oui, il s’agit d’une référence à Moins que zéro. Je l’ai lu ce livre une trentaine de fois, ça a été un choc pour moi. Ses personnages ont l’air d’être vide, ils traînent dans des décors désertiques et pourtant la sensation pour le lecteur est étrangement belle, presque fantastique. Je ne sais pas où il voulait en venir, mais il dit malgré lui quelque chose de fondamental sur notre modernité à tous, à savoir que dans un monde où on est tous les mêmes (dans Moins que zéro les personnages sont presque interchangeables) on n’a plus rien à se dire et l’on ne communique plus. Après, la chanson que j’ai faite s’inspire très indirectement du livre et son propos est limité. Elle évoque une attitude, à la fois fière et autodestructrice d’une personne qui se suffit à elle-même. L’idée était de faire parler l’individualisme. Ça a été l’un des mes premiers titres « rapés ». Il m’a permis de découvrir un timbre que j’ai beaucoup utilisé par la suite.
Dans l’ouverture de « Less Than Zero » tu chantes que tu vivrais bien dans une chanson si c’était possible. Ça m’a rappelé le morceau « Red Reggae Sonata » où tu chantes avoir rêvé du fantôme d’une chanson, et aussi ce que tu disais tout à l’heure à propos des chansons-maisons. Comme quoi ça va chercher loin cette histoire chez toi. Tu sembles vraiment vivre dans les chansons. A se demander si tu ne vis pas plus dans tes chansons que dans celles des autres ?
Ça peut paraître narcissique, mais oui, j’écoute énormément mes chansons. Je compose à flux tendu, pour mes propres besoins. Du moins, dans un premier temps. Par exemple, j’ai écrit « Less Than Zero » à une époque où je faisais de longs trajets à pieds. J’avais besoin d’une chanson sur laquelle on puisse marcher, d’une chanson courage pour la vie de tout les jours. Dans un autre genre, je me souviens qu’à un moment où je n’avais pas grand chose à quoi m’accrocher, je me suis beaucoup accroché à « Valium Years », qui est peut-être ma chanson la plus triste. Je l’ai joué en boucle pendant des heures, façonné comme un potier. Elle m’a sauvé d’une certaine façon. De quoi, je ne sais pas. Mais sauvé quand même ! A côté de ça, j’ai aussi tout un stock de chansons pour fumer des joints. Je pense que tu en as pratiqué une partie. J’aime l’idée selon laquelle les titres sont des produits et un album une sorte d’épicerie fine pour l’esprit. Aujourd’hui je consomme surtout de la musique électronique et du rap de la côte Ouest. Ou plus récemment, un peu de chanson française quand je vais vraiment mal. Mais j’ai peu de temps pour écouter de la musique. Ça me manque un peu mais je préfère faire plutôt qu’écouter.
J’ai en effet pratiqué une partie de tes chansons faites pour fumer des joints. A ce titre ouvrons donc, si tu le veux bien, une parenthèse par rapport à ta première démo, pour parler de ta deuxième, New Territories, où on trouve quatre instrumentaux bien planants. Tu veux parler de ceux-ci ?
Oui, notamment les deux plages instrus un peu chiantes que sont « Never Been To Los Angeles » (avec la batterie hip hop années 80 et trop d’abstraction) et « Labyrinth » (le truc très west coast et un peu dark avec un refrain plus Bob Sinclar). Parce qu’il y a aussi deux instrus plus cool, captivants : « The Whale Song » (avec le solo très psyché à la fin) et « International Airport » (avec le même riff tout du long qui grossit façon Phoenix).
C’est vrai tous ces instrus ne sont pas également captivants. Cette démo a d’ailleurs un côté pochette surprise, tous les styles y cohabitent mais sans que ça « jure » vraiment. Il y a même un morceau reggae un peu animateur de Club Med !
Oui, qui n’a pas de nom ! Et il y a aussi une chanson acoustique dans la même lignée que « Anti-Hedonist » (« Never Aligned »), un tunnel surf rock (« Song For Ali Boulala »), un morceau plus léger et dansant (« Hole in My Head »)…
Je le trouve très captivant, très tubesque ce guilleret « Hole In My Head », mais je crois que mon morceau favori sur ce disque, c’est « Burn in the Morning ». Pour moi, c’est un de tes grands morceaux. Il est envoûtant, aérien, incantatoire. Quand je l’écoute, je pense aux oiseaux, à l’aube qui se lève, un sentiment de libération. Ça me rappelle le « Vertige » de Camille, sur Le Fil, qui parle clairement d’oiseaux lui. D’ailleurs au départ je croyais que tu chantais non pas « Burn in the Morning » mais « Bird in the Morning »…
Oui, c’est sûrement le morceau le plus fort de ce disque. Je pense qu’il fait bien la synthèse de toutes mes influences : la rythmique est d’inspiration assez rap, mais la ligne de chant est une mélodie hybride, assez libre, que j’ai essayé de faire sonner comme une guitare électrique. La voix du couplet c’est encore un moment de transe pour moi… Je me souviens d’avoir joué le morceau sur le balcon d’un pote à Brooklyn, dans un quartier un peu ghetto, presque exclusivement black. Deux types se sont arrêtés et ont escaladé le balcon pour venir écouter. Puis sont reparties. J’étais fier, je me sentais noir moi aussi.
Pourquoi avoir appelé cette démo New Territories ?
Je l’ai appelé comme ça sous l’influence de la notion de « territoires » dont parle Gilles Deleuze (il s’agit en fait de « déterritorialisation », un concept qu’il a forgé avec Félix Guattari en 1972 dans L’Anti-Œdipe, ouvrage où ils louent par exemple Freud pour avoir libéré le psychisme en le déterritorialisatiant par le concept de libido, mais lui reproche d’avoir reterritorialisé la libido sur le terrain du drame œdipien – nda). Il dit que la musique est très liée aux territoires, au passage d’un territoire à un autre. Ce qui m’intéressait, c’était de faire une musique qui aide à conquérir de nouveaux territoires dans la vie de tous les jours. Une musique qui soit belle comme un sentiment de gloire, qui nous aide à combattre…
Bon, cette parenthèse effectuée, zappons si tu le veux bien les quatre derniers morceaux de ta première démo (« Asian Blue », « Weed and Cola », « Valium Years » et « Skateboarding in Slow Motion »). Arriver là, je me dis : « Putain, tous ces morceaux, c’est beau, c’est du travail, c’est pas rien. » Et en plus de ces 24 là, via ton Myspace, ton Soundcloud ou YouTube on peut en glaner encore 17 d’autres (« Under Palm Trees », « This Is My Last Lie », « Last Days », « On TV », « When The Night… », « The Little Feeling of Big Cities », « Darker Becommings », « Insularization », « Cold & Heav Stones », « No Jaguar », « Brooklyn 40°C », « Love », « The Golden Age », « Drowning in A Glass of Diet Soda », « The Mirror », « Lights », « Déchiré »). Je veux dire, avec tout ça (41 chansons plus que présentables en 5 ans de compo solo), potentiellement, tu tiens trois disques, et de haute tenue, sans remplissage. Or tout ça n’est pas connu, écouté, consommé. Est-ce que ça te déprime ou est-ce que tu t’accomodes avec cette notion d’infini, de rêve et d’irréalité ?
Je m’en accomode de moins en moins. C’est pour ça que j’opère depuis peu sous un nouveau pseudo : Basile Di Manski. (Avant j’opérais sous le peudo de Peter P et Peter P est mort !) C’est pour traduire un changement d’attitude. Basile Di Manski, ça se rapproche de mon vrai nom, c’est plus concret. Peter P, c’était l’abstraction, le rêve et quelque part le rêve comme résistance à la réalité et la musique en solitaire. Basile Di Manski, c’est Peter P qui descend de sa tour pour aller voir des potes ! Comme je te l’ai dit, je fais de la musique en premier lieu pour moi, parce que j’en ai besoin (c’est la cause). Mais d’un autre côté, j’ai envie que ma musique reste, qu’elle soit écoutée, consommée, transformée (c’est le but). Et j’ai toujours à l’idée qu’elle le sera, tôt ou tard. Je vois la route vers la notoriété comme un labyrinthe plus que comme une ligne de TGV. Labyrinthe où j’ai un pied.
A propos de concret : et ton quotidien ? Labyrinthe aussi ? Etudes ou gagne pain ?
J’ai fait 5 ans de droit, raté l’examen du Barreau l’année dernière, et je travaille aujourd’hui dans une boîte de production de spectacles où je m’occupe de la communication. Ça peut paraître paradoxal vu que jusque-là, je n’ai jamais su communiquer sur moi-même, mais c’est un choix délibéré de ma part. La production c’est un métier qui consiste, grosso modo, à transformer un rêve en produit. J’ai besoin d’apprendre ça. Je crois qu’il y a un temps pour confectionner son rêve de façon clandestine, puis un temps pour faire exister ce rêve en dehors de soi-même, le rendre public. Je viens de vivre une année mouvementée, mais je suis enfin entré dans cette seconde phase, en créant notamment Colony.
Oui, Colony, parlons-en. Ce nom de groupe c’est déjà tout un programme, je trouve, car les colonies c’est à la fois estival et violent, à la fois les colonies de vacances et les guerres de colonies. En t’entourant tu (te) signifies clairement ta volonté de t’ancrer et de monter en puissance ?
Oui, tu as tout compris. Colony, c’est la structure collective, le cadre indispensable à ce mouvement de concrétisation. Comme je te le disais, ça faisait un moment que je travaillais seul. Les titres qu’on vient d’évoquer sont finis depuis 2-3 ans. Ensuite, petit à petit j’ai eu de plus en plus de mal à trouver la force de travailler seul. Déjà, sur New Territories, un pote m’avait accompagné pendant la phase « dure » des enregistrements et de l’écriture et ça m’avait énormément aidé. Toutes ces chansons que j’avais en tête, j’ai eu très peur de les laisser filer. Mais je me suis dis : « Si tu continues à fonctionner en circuit fermé, petit à petit tu vas t’essouffler et plus rien ne sortira. » J’ai beaucoup réfléchi à ça et j’ai fait l’inventaire des 50 morceaux inachevés qui prenaient la poussière dans mon ordi. J’ai rassemblé mes meilleures bribes, des trucs de 20-30 secondes, et j’ai proposé à Nicolas LaFaccia, avec qui je jouais souvent, de m’aider à en faire quelque chose. On a passé tout l’été 2012 à bosser les instrus. C’était un vrai travail de composition, parfois désespérant, parfois exaltant avec des problèmes musicaux ou des problèmes de communication. Parfois, on passait juste des heures à parler, à hésiter. Sur l’un des morceaux, on n’avait qu’un refrain, et il a fallu composer jusqu’à 17 couplets différents pour que le 18e soit le bon. Mais du coup, les morceaux se sont énormément enrichis, notamment parce que LaFaccia vient d’un paysage beaucoup plus rock’n’roll que moi. Il a fait plus de scène, il est plus ancré, il m’aide à creuser et c’est une vraie source d’énergie. Et l’hiver suivant, Colony est devenu un vrai groupe en intégrant Hubert Corvette. A la base il est pianiste. Il a une vision très large de la musique. Il sait formuler et résoudre les problèmes techniques qui se posent quand on fait des chansons pop. On a passé une partie de l’hiver a travailler en studio et on a mis du temps à trouver un équilibre, mais aujourd’hui nous l’avons trouvé. Au contact de Corvette et LaFaccia, les morceaux ont pris une ampleur imprévisible, ils se sont chargés d’un tas d’affects que je n’aurais même pas pu envisager tout seul.
Super, et quelle est l’actu de Colony alors ? Il doit bien y en avoir une puisque Colony est une machine de guerre !
L’expansion jusqu’à la conquête du monde. Mais le plan doit rester secret. On recrute une graphiste. On aura bientôt un comptable et un cuisinier. On prolifère. On balancera les titres les uns parès les autres (pas d’EP) et on organisera des écoutes en avant-première. Le premier titre, « Forever After », sera disponible début novembre.
Parallèlement à la musique, tu écris des nouvelles en forme de contes poétiques. Je me rappelle que tu m’avais fait lire ça et que j’en avais gardé l’impression d’un « Petit Prince sous champi » ? Tu avais le projet d’un recueil et il paraît que tu as trouvé un éditeur…
Le processus d’édition est long et la rentrée littéraire une vraie jungle pour les jeunes auteurs mais oui, ça devrait sortir aux éditions de l’Harmattan. Je vois ce que tu veux dire par « Petit Prince sous champi », c’est vrai que dans leur récit ces nouvelles ont en effet quelque chose d’un peu psychédélique. C’est l’histoire d’une rencontre entre deux personnages. L’un, Saint-John d’Orange, est un Saint qui perd peu à peu ses pouvoirs. L’autre, le narrateur, qui dit « je », s’élève par l’imagination au-delà de sa condition. A un certain point, les deux hommes se rencontrent. Comme dans Intouchables !
C’est là qu’on retrouvera le côté rêveur handicapé de Peter P ?
Peut-être. Tu nous le diras.
Merci Basile.
Merci à toi Sylvain, vraiment, c’était un plaisir.
Photos 1, 2 et 4 réalisées par Joris Rossi
Soundcloud et Myspace de Basile di Manski